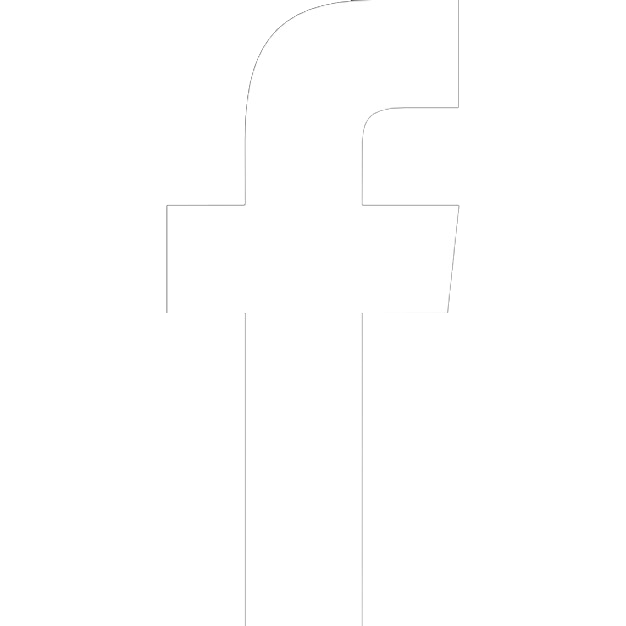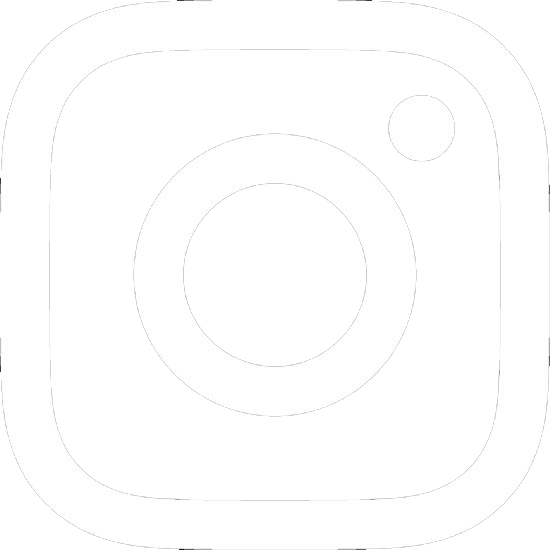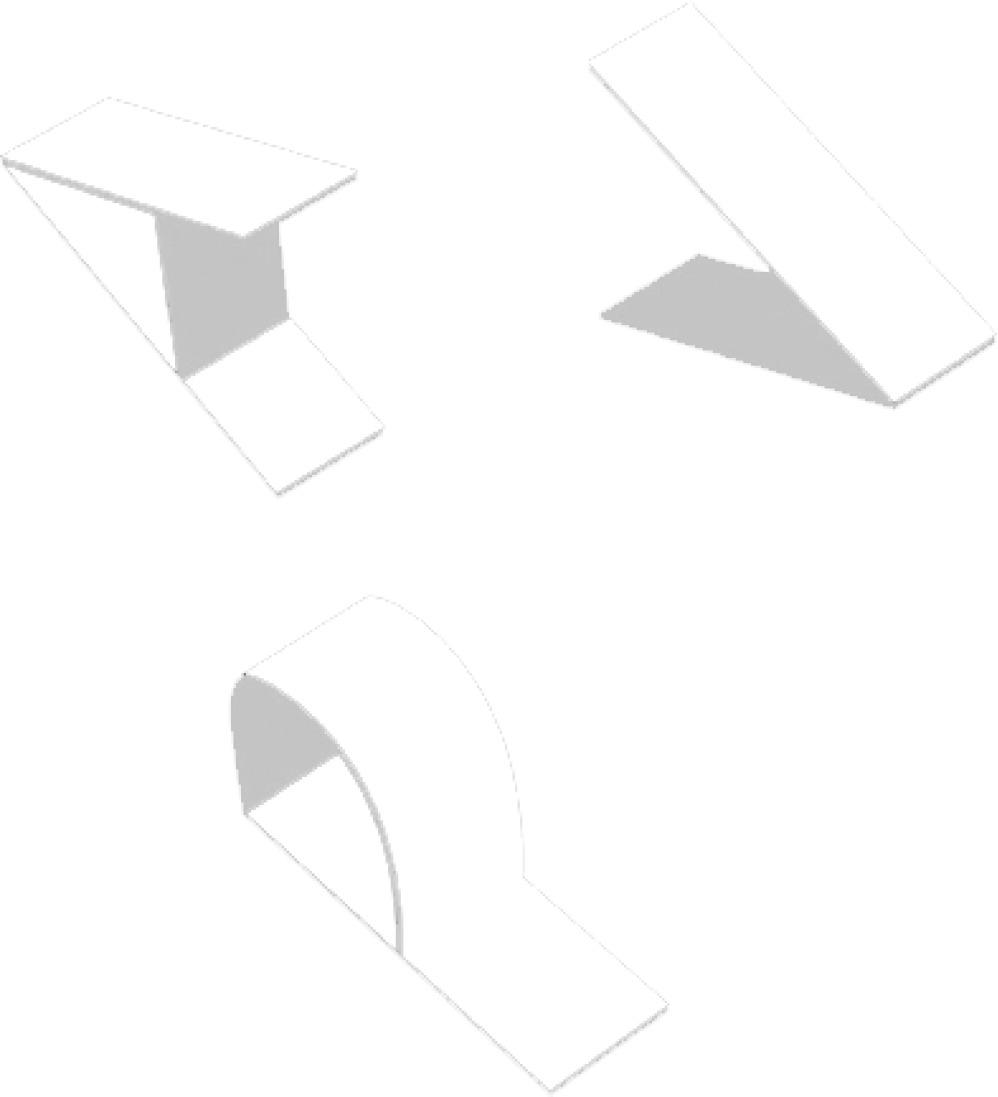Documents disponibles

Mundíal, Enrique Ramírez, 2017
Film réalisé par Sylvain Huet / Avis d’Eclaircies

Montage : Yoann Le Claire
Interview : Amélie Evrard
Exposition
Enrique Ramírez aime les histoires à tiroirs, les fictions chevauchant les pays et les époques, les mirages entre songe et réalité. L’œuvre de cet artiste chilien, qui vit et travaille entre le Chili et la France, se concentre sur la forme vidéographique et les installations : c’est souvent par l’image et le son qu’il construit ses intrigues foisonnantes et s’insinue en équilibre entre le poétique et le politique. Son imaginaire gigogne s’arrime dans un élément obsessionnel — il pense à partir de la mer, espace mémoriel en perpétuel mouvement, espace de projections narratives où s’entrecroisent le destin du Chili et les grands récits liés aux voyages, aux conquêtes, aux flux migratoires. Liquides, ses images disent le miroitement d’une vérité toujours fuyante, le ressac de l’Histoire, toujours la même, jamais pareille.
À travers la mer, c’est aussi la figure de son père qu’il convie — un père fabriquant de voile sous la dictature Pinochet, un homme qui métaphorise tous les fantasmes du voyage doublés d’une existence politiquement contrainte. Les résonances biographiques vibrent fréquemment dans les recherches d’Enrique Ramírez : il l’a montré avec Los Durmientes [Les Dormeurs] (2014), triptyque vidéo qui aborde les heures les plus sombres de son pays, lorsque l’état faisait disparaître en mer quelques 500 corps dissidents, lestés de traverses de chemin de fer, que la langue espagnole nomme – ironie du sort – les dormeurs. Mais si l’artiste fait intervenir l’histoire fictive de sa grand-mère en voix off, il convoque également le point de vue des militaires, ceux qui ont laissé choir des hélicoptères le corps des suppliciés tourbillonnants, tout comme la vision de tombes flottantes qu’il a lui même installées comme un mémorial dérisoire, filmé au ras des vagues. C’est la complexité des évènements et leur mise en récit éclaté qui semble fasciner Enrique Ramírez, l’impossibilité de relire le passé à l’aune d’un seul prisme sans cautionner ce que dénonce Georges Orwell dans 1984 : l’Histoire comme arme d’endoctrinement, de falsification et d’oubli.
Pour éviter l’écueil de toute vision univoque, l’artiste choisit volontiers la voie qu’ont emprunté avant lui certains romanciers ou cinéastes d’Amérique latine, tels Gabriel Garcia Marquez, Jorge Borges ou Raoul Ruiz : l’insert d’éléments magiques et de motifs surnaturels, dans des situations rattachées à un cadre historique, culturel et géographique avéré. Dans la vidéo Cruzar un muro [Traverser un mur] (2013), il met ainsi en scène trois personnes dans la salle d’attente d’un bureau de l’immigration, perdues dans leurs pensées. Tout tangue dans l’image, les esprits comme la salle, dont on s’aperçoit qu’elle est en fait une plateforme flottant au milieu de l’eau, situation surréaliste qui permet justement à l’artiste d’orchestrer poétiquement la dérive comme la divagation. Mais en filigrane, ce sont bien les politiques migratoires des pays occidentaux qu’il met en examen.
À l’invitation du Grand Café, Enrique Ramírez conçoit une exposition palimpseste, feuilletée de multiples références géographiques et historiques : intitulée Mundíal, cette proposition est parcourue de distorsions spatio-temporelles et pourtant, il s’en dégage une profonde cohérence réflexive, tant l’artiste se plaît à ouvrir des espaces d’affinités intellectuelles ou oniriques. Sans heurts, le contexte maritime proche (Saint-Nazaire, Ouessant) rencontre ainsi la Guerre froide ou le suicide de Salvador Allende, et l’histoire intime (la voilerie du père de l’artiste) se fait le réceptacle d’histoires anonymes et oubliées. La perspective ethnographique, l’image d’archive et la fable ne sont pas en demeure : la photographie d’un personnage devenu voile humaine croise le destin d’un immigré nigérien au Chili qui ne sait pas nager, la mélopée des voix off entrelace les langues et la sensualité des accents, tandis que les étoiles creusent d’étranges percées dans l’espace-temps, suggérant, peut-être, que le futur est derrière nous.
Dans cette profusion d’échos et de mises en relation, Enrique Ramírez épanouit une pensée critique qui n’est jamais dogmatique : proche du philosophe Georges Didi-Huberman et de la vision de l’art qu’il défend dans son ouvrage Survivance des lucioles, l’artiste relève plutôt les trouées lumineuses, exhume les « parcelles d’humanité » et déplace le regard. Pour mieux déjouer le pouvoir ?
L’exposition du centre d’art accueille une toute nouvelle production d’Enrique Ramírez, tournée sur l’île d’Ouessant et au Chili. Intitulée Dos brillos blancos agrupados y giratorios [Deux faisceaux blancs groupés et rotatifs] (2016), cette vidéo met en scène le sémaphore du Créac’h, qui toutes les dix secondes émet un éclair blanc pour montrer la voie aux voyageurs de la mer, qu’ils arrivent du Nouveau Monde ou de la fin du monde, le Finistère. Dans cette œuvre crépusculaire, la mer apparaît calme ou tourbillonnante, filmée en topshot (plongée totalement verticale) ou en vol rasant : les effusions d’écume tranchent sur la matière sombre, tels des mondes cartographiques qui se font et se défont sans cesse ; le faisceau de lumière troue mécaniquement le ciel nocturne, et de multiples voix accompagnent cette chorégraphie élémentaire. L’une d’elle nous invite à découvrir les croyances de certaines tribus indiennes, qui pensaient que les tâches blanches du ciel (les étoiles) étaient des trous par où la lumière de l’univers entrait, et que l’obscurité n’y existait pas. D’autres voix célèbres ravivent de grands moments d’histoire politique, mots incandescents qui ont guidé l’humanité, ou évocations d’événements tragiques qui l’ont désemparée. Discours de Luther King, Castro, Bush, mais aussi des textes de fictions écrits par l’artiste ou des poèmes : cette bande son multiplie les incantations à l’utopie, comme pour inspirer la possibilité d’imaginer de nouvelles paroles utopiques aujourd’hui. Enrique Ramírez confirme ici la dimension existentielle et générique de son univers, structuré en profondeur par le motif du cycle, de la révolution, de l’éternel recommencement. Pas de moralisme dans cette approche méditative : l’artiste suggère bien davantage des cheminements buissonniers de pensée, et l’expérience d’une immersion dans le bruit du monde.
En regard de cette projection, Enrique Ramírez installe un bateau retourné, qui transperce de son mât le plafond de la salle d’exposition et dont la coque apparaît au premier étage. Tel un second phare métaphorique, la voile-signal capte la lumière des images, surface flottante qui semble défier les lois de la gravité. Rouge et blanc, ce pavillon de navigation signifie le danger. Il renvoie également, par sa situation renversée, à un dessin du peintre uruguayen Joaquín Torres García, dont le titre est justement América Invertida [l’Amérique inversée] (1943) : en basculant ce continent, en mettant les cartes à l’envers, l’artiste repositionne les perspectives et les points de vue de l’histoire sur les rapports Nord/Sud.
L’exposition ménage ainsi plusieurs voyages, reliés à des événements historiques précis (Coup d’Etat du Chili du 11 septembre 1973, Attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis) comme aux péripéties actuelles de « peuples sans terre », auxquels sera dédiée une monnaie de cuivre spécialement frappée pour l’exposition.
À nouveau, il invite au regard empathique et imbrique son histoire personnelle, familiale, dans la grande histoire qu’il revisite ici. Mais si le traitement est poétique, le fond n’en demeure pas moins politique, très proche des mots d’Aimé Césaire dans son Discours sur le colonialisme, lorsqu’il assimile la colonisation à un « principe de ruine », ou qu’il écrit : « colonisation = chosification ». Lorsqu’Enrique Ramírez réactive ces grands enjeux idéologiques du XXe siècle (la colonisation, la migration contrainte), ceux qui hantent l’ensemble de la psyché humaine encore aujourd’hui, il vise précisément ce que contient le titre de son exposition : Mundíal — ou comment ressaisir dans l’art ce vaste lieu commun, au sens propre comme au sens figuré, qu’est le monde.
Éva Prouteau
Production
Œuvres
40 x 48 cm (chaque), Encadrement : 52,5 x 62 x 5 cm (chaque)
Edition de 5 exemplaires et 2 épreuves d'artiste
59 x 70 cm
Edition de 5 exemplaires et 2 épreuves d'artiste
Cadre 51 x 101 x 2,5 cm
3 min 15 s
Edition de 5 exemplaires et 2 épreuves d'artiste
7 min 59 s
Edition de 5 exemplaires et 2 épreuves d'artiste
Production Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago, Chili
150 x 150 cm
21 x 29,7 cm
14,8 x 10,5 cm
60 x 40 cm (encadré)
14 x 9 cm
Biographie
Né en 1979.
Vit et travaille à Paris et Santiago du Chili.
L’artiste est représenté par la galerie Michel Rein (Paris et Bruxelles).